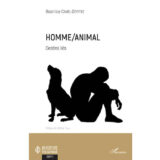En septembre 2025 une intrusion au centre de primatologie de Niederhausbergen, près de Strasbourg, a entraîné la disparition de douze ouistitis. Deux ont depuis été retrouvés vivants, mais les chances de survie de ceux qui restent à l’extérieur sont faibles. Ces petits primates, originaires d’Amérique du Sud, habitués à un environnement tropical reconstitué, ne sont pas armés pour affronter la nature alsacienne.
L’événement a suscité l’émoi médiatique. Pourtant, il ne s’agit pas seulement d’un fait divers : il soulève des questions fondamentales sur l’expérimentation animale en France. Plus de 800 singes sont détenus dans ce centre, utilisés à des fins biomédicales ou comportementales, privés de liberté et soumis à des conditions de vie contraires à leurs besoins fondamentaux. Les ouistitis et les autres primates utilisés dans la recherche souffrent d’un double enfermement : celui de leurs cages et celui d’un système scientifique encore fondé sur l’exploitation animale. Leur existence n’est connue du grand public qu’à la faveur de tels incidents.
Un système archaïque sous perfusion
L’expérimentation animale est souvent présentée comme indispensable au progrès scientifique. Or, les critiques s’accumulent depuis des décennies, bien au-delà des cercles militants. Médecins, chercheurs et scientifiques de renom soulignent régulièrement les limites de la transposition des résultats obtenus sur les animaux à l’humain. Des traitements prometteurs chez le primate se révèlent inefficaces ou dangereux une fois testés en clinique, retardant parfois la mise au point de thérapies réellement adaptées.
Ce paradoxe révèle un système scientifique et industriel enfermé dans ses routines. Comme je l’analysais déjà en 2011, l’expérimentation animale survit moins par sa pertinence que par le poids de ses intérêts économiques, institutionnels et culturels. Elle est devenue une habitude, un réflexe méthodologique, plutôt qu’une nécessité scientifique.
Des alternatives crédibles et modernes
Pendant ce temps, les méthodes alternatives progressent à grands pas. Cultures cellulaires, organoïdes, biopuces, modélisations informatiques et intelligence artificielle ouvrent des perspectives infiniment plus fiables pour comprendre les maladies humaines et tester des molécules. Ces technologies permettent d’obtenir des résultats spécifiques à l’humain, de réduire les délais et de limiter les coûts.
Malgré cela, leur développement reste freiné par l’inertie réglementaire et par les intérêts économiques qui gravitent autour de l’expérimentation animale. Le centre de Niederhausbergen est ainsi le symbole d’une science en retard sur elle-même, accrochée à des pratiques d’un autre âge alors que la société réclame davantage d’éthique et d’innovation.
La souffrance cachée derrière les murs
Les singes de Niederhausbergen, comme tant d’autres animaux de laboratoire, vivent une vie réduite à des numéros d’inventaire et à des procédures invasives. Leur « bien-être », invoqué dans les communiqués officiels, reste largement illusoire : un primate arraché à sa liberté ou né en captivité, maintenu en cage et soumis à des manipulations expérimentales, ne peut connaître une existence conforme à ses besoins fondamentaux.
L’intrusion qui a conduit à la fuite ou au vol de plusieurs ouistitis révèle, malgré elle, cette réalité cachée. Si l’on s’inquiète à juste titre de leur survie dans la nature, il est urgent de s’interroger sur leur quotidien derrière les murs : une souffrance permanente, invisible au grand public.
Sortir du piège éthique et scientifique
La France, comme l’ensemble de l’Europe, doit avoir le courage de tourner la page de l’expérimentation animale. Cela suppose d’investir massivement dans la recherche alternative, de fixer un calendrier clair de sortie et de garantir une transparence totale sur l’utilisation des animaux dans les laboratoires.
L’affaire de Niederhausbergen nous rappelle que le véritable scandale n’est pas l’intrusion elle-même, mais le fait que des centaines de primates soient encore enfermés et utilisés dans nos centres de recherche. Il est temps de choisir une science moderne, éthique et tournée vers l’avenir — une science qui ne repose plus sur la souffrance des animaux, mais sur des méthodes réellement adaptées à l’humain.

Béatrice Canel Depitre
Essayiste