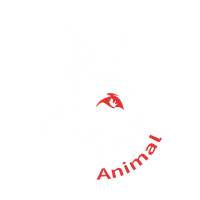Dotés de capacités olfactives hors-normes, les chiens sont désormais capables de détecter les personnes infectées par le Covid en reniflant leur sueur. Initié par le Pr Dominique Grandjean (vétérinaire et enseignant-chercheur à l’École nationale vétérinaire d’Alfort), le programme Nosaïs-Covid-19 connaît un véritable succès à l’étranger mais peine à décoller en France.
Comment est né le projet Nosaïs-Covid-19 ?
Le programme Nosaïs existe depuis plus de deux ans maintenant et a pour finalité de développer le chien de détection médicale. En France, les cancers de la vessie et la maladie de Parkinson étaient nos premières cibles. En revanche au Liban, avec Riad Sarkis (professeur de l’Université de Beyrouth, NDLR), nous nous sommes focalisés sur les cancers du côlon. Pour l’instant, c’est un sans-faute.
Lors du premier confinement début mars, Riad Sarkis gérait les patients atteints du Covid à l’hôpital de Beyrouth et m’a confié qu’il sentait une odeur particulière dans les chambres des malades infectés par le SARS-CoV-2. En discutant, il a réussi à me convaincre d’aller plus loin et de là est né le projet Nosaïs-Covid-19. Une phase d’étude a ensuite été entreprise. Nous avons cherché à savoir si des recherches avaient déjà été effectuées au préalable.
Certains virus ont une odeur spécifique et nous nous sommes rendus compte que des chercheurs de l’Université Auburn (Alabama) avaient travaillé sur un projet similaire démontrant la capacité des chiens à détecter une maladie des muqueuses chez les bovins. Nous avons réfléchi à l’expérimenter sur des malades atteints du Covid pensant que ça pouvait fonctionner. Les essais devaient confirmer ou non cette hypothèse.
Une personne infectée dégage des composés organiques via les émonctoires du corps humain (organes capables d’éliminer les déchets comme les toxines, NDLR). La peau est une bonne candidate car elle en rejette par la sueur grâce aux glandes sudoripares et la sueur est le seul liquide biologique qui n’extrait pas le virus. Elle ne présente donc pas de risque de contamination. Ses caractéristiques ont été analysées sur différentes parties anatomiques et c’est sous les bras qu’elle s’est avérée la plus odorante. Il nous fallait ensuite trouver les chiens et un mode de formation.

Quelle est la technique de dépistage utilisée ? Par quelles étapes le chien passe-t-il pour reconnaître l’odeur d’un individu infecté par le SARS-CoV-2 ?
Nous sommes dans un cadre de technique assez standard. Des compresses imbibées de sueur de personnes infectées sont fournies par des hôpitaux et placées dans des petites boîtes situées à l’arrière d’un cône. Au départ, les chiens apprennent simplement à y mettre leur truffe, ce qui n’est pas évident lorsqu’ils sont habitués à travailler sur des grandes surfaces. On y glisse des jouets pour attirer leur attention.
Une fois cette étape passée, nous y déposons des prélèvements positifs pour qu’ils s’imprègnent de leur odeur commune. Progressivement, nous introduisons des neutres et des négatifs et les chiens sont récompensés lorsqu’ils en trouvent des positifs. Une validation est ensuite effectuée en double aveugle nous permettant d’établir les valeurs de sensibilité et de spécificité du chien. Actuellement, la moyenne est comprise entre 94 et 95% de réussite en termes de sensibilité et entre 96 et 99% en termes de spécificité.
Tout cela prend du temps. Pour le premier groupe de chiens, presque deux mois ont été nécessaires. Pour le deuxième, le processus a été plus court, six ou sept semaines validation comprise. Dans ce cadre de recherches spécifique, nous devons agir de manière structurée.
Le programme a obtenu le soutien de l’OMS et a suscité beaucoup d’intérêt à l’étranger. De nombreux pays se sont inspirés de votre méthode d’apprentissage. Travaillez-vous en étroite collaboration avec eux ?
Nos contacts proviennent le plus souvent d’universités ou des ministres de la Santé. Une fois la discussion entamée, le programme leur est expliqué avec à l’appui, nos textes scientifiques et un guide d’une soixantaine de pages avec photos. Puis, des visioconférences sont régulièrement organisées pour suivre leurs avancées. Des fils WhatsApp sont aussi mis à leur disposition où ils peuvent nous envoyer questions et vidéos. Au début, c’était facile à gérer avec juste quelques pays en demande. Aujourd’hui, avec 24 pays, la gestion est difficile surtout avec le décalage horaire.
A l’heure actuelle, ce sont les émirats arabes unis les plus avancés dans le programme Nosaïs. Ils ont mis en place ce système dans trois aéroports internationaux et développent actuellement des unités mobiles. Le Liban, le Chili et la Finlande sont aussi très impliqués. L’Australie, elle, a déployé 14 chiens à l’aéroport de Sydney et son Premier ministre a annoncé qu’il s’agissait désormais d’une priorité en termes de dépistage. Toutes les structures avec lesquelles nous travaillons sont super motivées. Nous n’avons pas l’impression d’être inutiles.
Ce système peut être déployé partout : dans les clusters, aux frontières, sur une catégorie de population mais aussi en Ehpad. Un partenariat avec Handi’chiens a d’ailleurs démarré. Aujourd’hui, 350 chiens d’assistance sont présents dans les Ehpad. Ceux qui le souhaitent pourront désormais former leurs chiens à la détection du Covid par l’association. Ils seront autonomes et auront un « outil » de dépistage permanent. De plus, ce sera plus agréable qu’un écouvillonnage nasal.
J’ai élaboré un plan de déploiement il y a quelques mois à la demande de la DGS (Direction générale de la santé) mais sans suite de leur part. Pour bien faire, il faudrait une décision centrale qui valide le chien comme dispositif médical avec un plan de formation au niveau national. Dans l’éventualité où ce dispositif coûterait un million d’euros, cette somme serait finalement dérisoire quand on voit les milliards claqués pour rien.
Ce programme assure un dépistage ultra-précoce et se veut peu couteux pour la société. Comment expliquer le manque d’intérêt des autorités françaises pour ce projet ?
Je n’ai pas la réponse. J’ai eu beaucoup de discussions, j’ai même reçu des menaces de la part de certains fonctionnaires. Vous ne pouvez rien faire quand vous êtes face à un mur. Je vois bien qu’à la DGS, certains y sont favorables mais il y a un blocage. Est-ce un blocage de lobbying de la part de certains labos ? Est-ce un blocage de paradigme ? Est-ce peut-être trop simple ? Aujourd’hui, nous sommes dans une société où les approches médicales simples et efficaces ne doivent pas voir le jour.
Pourtant, l’OMS nous a apporté son soutien et c’est très important pour nous. Un groupe international a d’ailleurs été créé dans lequel nous sommes avec l’OIE (World Organisation for Animal Health). L’objectif est de fournir des standards aux pays en demande, ce qui est fait actuellement. Un type de formation leur est transmis avec un accompagnement et un suivi au quotidien. Je ne comprends pas pourquoi la France ne bouge pas. Là c’est le néant et le néant inspire plutôt du mépris.
Grâce à leur compétence olfactive hors-norme, les chiens ont bien souvent contribué à aider la médecine. Peuvent-ils être considérés comme de véritables dispositifs médicaux ?
Bien sûr. Le problème de la DGS était de ne pas avoir de publications scientifiques. Pourtant, la première leur a été envoyée le 4 juin dernier et a été publiée le 10 décembre. Il y a un vrai décalage dans le temps. Tous les résultats leur sont fournis au fur et à mesure mais c’est stationnaire. En ce moment ça bouge un peu mais désormais, ça butte au niveau légal. Ils se demandent comment faire du chien un dispositif médical sachant qu’il existe plusieurs catégories de dispositifs médicaux.
Sur mon compte Facebook, j’ai d’ailleurs illustré la situation de manière humoristique en partageant une publicité des collants DIM où est inscrit « dispositif médical ». Alors si on peut faire du collant un dispositif médical, pourquoi ne pourrait-on pas y parvenir avec des chiens ? Je ne comprends pas tout.

Les chiens sont-ils tous capables de « flairer » le SARS-CoV-2 et votre chienne Noona fait-elle partie de l’équipe ?
S’il est éduqué, n’importe quel chien est capable de le faire mais on gagne du temps lorsqu’on choisit des chiens déjà formés à la détection olfactive car ils savent se servir de leur nez et ce qu’est un marquage.
Ma chienne Noona a fait partie de l’équipe mais je l’ai retirée parce que je voulais qu’elle se focalise uniquement sur les cancers de la vessie. C’est l’exemple type du chien qui n’avait jamais rien sniffé. Elle a commencé lorsqu’elle avait six mois. Elle a compris qu’il fallait mettre son nez dans le cône, sniffer et faire un marquage pour recevoir une récompense. C’est rigolo. Sur Internet, certains internautes ne comprennent pas et plaignent les chiens. Ils parlent d’exploitation mais n’y connaissent rien. Les chiens s’amusent, sont heureux de faire ça. Pour eux, c’est un jeu.
Cette crise sanitaire pourrait être l’occasion d’introduire la notion de la santé globale. Vous êtes pour l’initiative « One Health », « un monde, une santé unique ». Selon vous, les vétérinaires devraient-ils être impliqués davantage dans les recherches pour lutter contre cette pandémie ?
Nous avons tous le sentiment d’être pris pour des yoyos. Il y a un vrai paradigme. Les médecins technocrates pensent toujours que les maladies sont uniquement dévolues aux médecins mais non. Surtout lorsqu’il s’agit de maladies infectieuses comme celle-ci. Nous devons travailler tous ensemble au profit de la santé publique.
Au tout début de la crise sanitaire, les laboratoires avaient du matériel qui leur permettaient de faire trois ou quatre tests PCR par jour alors que les laboratoires vétérinaires avaient l’habitude et la capacité d’en faire 1.500 à 2.000 mais on les a écartés. Ce potentiel n’a pas été utilisé alors que le moment était critique. Nous avions besoin de déployer des tests.
C’est exactement le même schéma aujourd’hui. Nous traversons une deuxième vague, bientôt une troisième. Le secret de la réussite consiste à tester et isoler les positifs. Aujourd’hui, on nous sort des tests antigéniques avec une sensibilité à 50%. C’est comme si vous lanciez une pièce en l’air. Vous avez une chance sur deux d’avoir bon donc autant ne pas le faire le test. Les vétérinaires sont clairement furieux. Il n’y a pas que moi. La profession entière pense qu’ils n’ont pas fait cas du concept « One Health ».

Amandine Zirah
Rédactrice freelance