Dans l’arène, le soleil se couche à l’horizon.
La poussière qui s’élève sous le vent a un parfum métallique, un parfum de sang, le goût de la cruauté et de la mort.
Le silence assourdissant hurle ce que certains refusent d’entendre.
Et puis, surgissant dans cette scène de mort, le taureau fait son entrée, majestueux, innocent et impuissant face au destin qui l’attend.
Chaque pas résonne comme une liberté brisée, chaque souffle, chaque regard crient : À bas la violence.
La corrida n’est pas un art.
Encore moins une fête.
Elle est un rituel de souffrance, une barbarie maquillée sous des habits de lumière, qui tente de séduire le profane, par des airs de fanfare et l’attrait du spectacle.
On nous dit que c’est une tradition. Mais de quelle tradition s’agit-il ?
La corrida n’est entrée en France qu’au XIXᵉ siècle, sous le Second Empire. Napoléon III l’a importée d’Espagne pour flatter un exotisme impérial et satisfaire les désirs de son épouse, Eugénie de Montijo.
Dès son apparition, elle fut rejetée par le peuple français.
Victor Hugo écrivait :
« Torturer un taureau, c’est torturer une conscience. »
Émile Zola dénonçait « l’ivresse de sang » imposée aux foules.
André Maurois écrivait :
« La corrida est un spectacle de souffrance qui n’a aucun mérite. »
Albert Schweitzer rappelait :
« Le respect de la vie exige que l’on refuse la cruauté comme spectacle. »
Même l’Église s’est élevée contre cette cruauté.
Dès le XVIᵉ siècle, le pape Pie V condamnait les courses de taureaux, déclarant qu’elles étaient « contraires à la dignité humaine et à la protection des créatures de Dieu ».
Même les juristes du Second Empire rappelaient que ce spectacle violait déjà la loi Grammont de 1850, qui interdisait de maltraiter un animal en public, bien que son application fût limitée par des exceptions.
Et pourtant, elle survécut.
Tolérée, parfois protégée, souvent imposée par la violence.
Non pas parce que le peuple la voulait, mais parce qu’une minorité l’imposait.
Aujourd’hui, les Français sont clairs : de 77 % à 80 % selon les sondages sont favorables à l’interdiction de la corrida.
L’opinion publique la refuse, la conscience collective la condamne.
Et pourtant, dans certaines villes, on continue de tuer.
Pire encore : certains maires financent cette barbarie avec de l’argent public.
Des centaines de milliers d’euros pour des arènes souvent déficitaires.
Une cruauté minoritaire, coûteuse, injustifiable.
Le peuple dit non.
Des élus complices financent, avec de l’argent qui ne leur appartient pas.
La violence ne touche pas que les taureaux.
Chaque année, des toreros et des chevaux sont blessés, parfois tués.
La corrida est un spectacle où la vie humaine et animale est mise en danger pour le plaisir de quelques-uns.
La fête ne s’écrit pas avec du sang.
La danse, la musique, les chants, le folklore authentique : voilà nos vraies traditions.
La beauté n’a jamais eu besoin de cadavres.
L’art n’a jamais eu besoin de cruauté.
La fierté ne naît pas de la mort.
On nous parle de courage… mais quel courage y a-t-il à frapper un être condamné, à qui l’on ne laisse aucune chance ?
La vraie bravoure réside dans la protection, dans le refus de la barbarie, dans le choix de la vie.
Depuis plus de cent-soixante-dix ans, des voix s’élèvent : écrivains, philosophes, poètes, citoyens courageux.
Victor Hugo dénonçait les « spectacles d’agonie » qui déshonorent la civilisation.
Romain Rolland appelait à « abolir la honte des arènes ».
André Gide rappelait : « On n’honore pas la force en la détruisant. »
Hier comme aujourd’hui, ces voix disent la même chose : la corrida est une tache sur notre humanité, une souillure sur notre drapeau.
Chaque cri étouffé par le sang versé nous regarde et nous interpelle.
Chaque regard effrayé nous accuse.
Ne pas voir, c’est se rendre complice.
Ne pas agir, c’est accepter l’injustice.
La corrida n’est pas seulement une affaire d’animaux.
Elle est un miroir des pires turpitudes de l’homme.
Elle reflète ce que nous tolérons encore.
Elle questionne notre humanité.
Sommes-nous une société qui érige la souffrance en spectacle ?
Ou une société qui choisit la justice et la compassion ?
L’adieu aux larmes ne se fera pas seulement par l’indignation.
Il doit passer par la loi.
Il est temps que la République mette fin à cette exception indigne.
Il est temps que députés et sénateurs entendent ce que dit déjà la société.
Il est temps que la France rejoigne les nations qui, par dignité, ont aboli ces pratiques.
Abolir la corrida n’est pas une atteinte à la culture.
C’est un progrès moral.
Un geste de justice.
Un acte de civilisation.
Éteignons les lumières des arènes.
Rendons aux prés la force et la grâce.
Rendons au taureau le droit de vivre, le droit de marcher libre.
Que la fête renaisse, mais sans cadavres.
Que la mémoire des innocents guide notre avenir.
Osons dire non à la violence.
Osons dire oui à la vie.
Car ce combat n’est pas seulement pour les animaux.
Il est pour nos valeurs, pour la cohérence de notre conscience, pour notre humanité.
L’adieu aux larmes est possible.
La grâce peut renaître.
La justice peut triompher.
Alors seulement, notre culture pourra se tenir debout.
Fière. Belle. Humaine.
Osons le dire : la corrida doit disparaître.
Photo : http://unsplash.com/

Guillaume Prevel
Conseiller régional Ile-de-France du Parti animaliste
Correspondant des Hauts de Seine du Parti animaliste

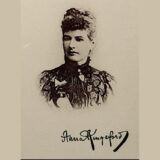




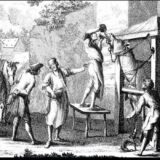






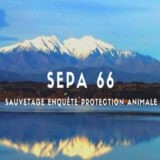













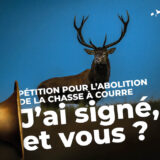





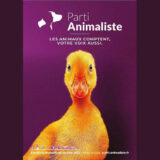





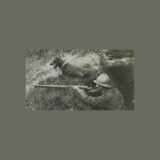


















2 commentaires
Gaston F.
1 septembre 2025 à 12h53
Un conseiller régional du sud ou sud-ouest sera mieux à même de parler de la corrida et de l’autoriser ou non.
Un conseiller d’Île-de-France devrait s’occuper de problèmes en Île-de-France et ne pas en créer ailleurs.
rgourp@neuf.fr
31 août 2025 à 18h57
Merci pout ce texte
Cordialement
Robert Gourp