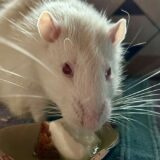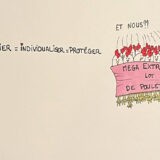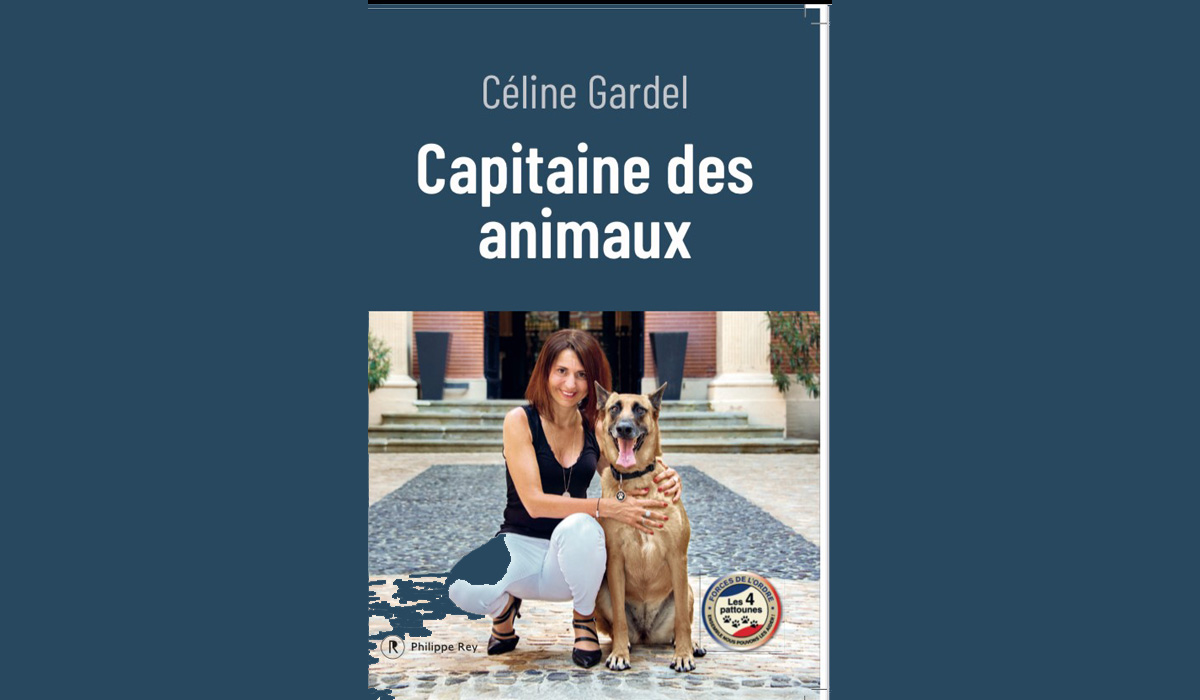« Ce chien est méchant », c’est une phrase que tout vétérinaire praticien a entendu maintes fois dans son exercice, et le devenir de ces chiens « méchants » fait souvent beaucoup réagir au sein de la protection animale : la récente euthanasie du chien Smoke et le devenir incertain pour les mêmes raisons du chien Usko en sont les derniers exemples. Le but n’est pas ici de polémiquer mais simplement d’exposer le point de vue déontologique du vétérinaire mis face à un tel cas. Et tout d’abord, commençons par différencier “méchant” et “agressif” : le terme « méchant » est purement humain, il n’est pas forcément lié au tempérament inné du chien mais peut être acquis pendant sa vie pour plusieurs raisons.
Un chien « méchant »… Comment le définir ?
Ce n’est pas une définition si simple à donner, car la perception de la méchanceté dépend beaucoup de la sensibilité et de la réceptivité de la personne qui l’énonce : une personne connaissant et possédant des chiens sera de facto plus à l’aise avec un chien inconnu qu’une autre ayant eu par exemple dans son enfance une « mauvaise expérience » jamais expurgée. On peut avancer qu’un chien méchant va réagir agressivement face à ce qu’il prend pour une menace, quelle qu’elle soit, ou à ce qui nous apparait être sans raison. Mais ces termes posent d’eux-mêmes le questionnement : « ce qu’il prend pour une menace » n’en est peut-être pas une, certes, mais il nous arrive de réagir de la même façon. Peut-on reprocher à une chienne de réagir agressivement quand un inconnu, fût-il bienveillant, s’approche de ses petits, par exemple ? Et ce qui nous apparait une réaction « sans raison » en cache peut-être une qui ne nous est pas compréhensible, le monde canin n’est pas le monde humain. Tout au plus pourrions-nous dire qu’un chien « méchant » est un chien qui nous semble réagir agressivement de manière disproportionnée, et surtout sans avoir « prévenu ».
Car un chien « bien dans ses pattes » prévient généralement lorsque quelque chose risque de l’amener à mordre : dans sa posture, raide, tendu, poils du dos hérissés, queue haute…et dans les sons qu’il émet : grognements, puis en montrant les dents. Ensuite seulement vient la morsure. La lecture de ce langage corporel permet de faire cesser ce qu’il considère comme une menace. Le danger consiste à ne pas savoir lire ce langage (comme les enfants…) ou à passer outre. Mais le danger réel consiste en la disparition de ces séquences d’alerte, lorsque le chien passe sans préavis directement à l’agression et à la morsure, comportement qui peut être autant inné qu’acquis. Et la première raison pouvant amener à ce geste « instinctif » est la douleur.
La douleur peut rendre un chien méchant…
Tout comme nous, ou tout être sensible ! La toute première chose que doit faire un vétérinaire devant un chien supposé méchant est de procéder à un examen médical consciencieux : toute douleur physique peut provoquer une réaction de morsure sans signes avant-coureurs, par exemple en touchant l’oreille d’un chien souffrant d’une otite sévère. Un chien victime d’un accident de la route pourra vouloir vous mordre si vous voulez le soulever. Les douleurs chroniques telles que celles liées à l’arthrose peuvent également être à l’origine de réactions sans préavis, par peur, par anticipation de cette douleur. Nulle méchanceté dans ces attaques pourtant non annoncées parfois par des grognements. D’autres troubles physiologiques peuvent être à l’origine des dysfonctionnements dans les réactions d’un chien jusque-là parfaitement équilibré : des troubles hormonaux, notamment liés aux hormones sexuelles ou thyroïdiennes, peuvent être à l’origine d’hyperréactivité voire d’agressivité. Le parallèle est facile à faire avec les troubles de la thyroïde chez les humains, par exemple, et rend la compréhension du phénomène plus aisée. La liste des causes « physiques » à l’agressivité est longue, ce ne sont ici que quelques exemples pour mettre en évidence l’obligation d’un examen clinique poussé sur un chien présenté comme « méchant » pour exclure toute cause physiologique à ce comportement.
Si ce n’est pas physique, est-ce comportemental ?
Si aucun souci physiologique n’est plus suspecté, le praticien va alors se pencher sur des troubles dits comportementaux. Si le chien présente des signes d’agressivité réelle, il devra en tout premier lieu, sécuriser la famille : en effet, on l’ignore souvent, le vétérinaire soigne les animaux mais il possède un rôle central également dans la santé publique pour laquelle il est missionné. La protection des humains, surtout les plus vulnérables, vis-à-vis des animaux en fait partie. Il devra donc conseiller des mesures de prudence, voire d’éloignement par rapport à des personnes particulièrement fragiles, dont les enfants. Ensuite, il devra rechercher de quel trouble peut souffrir le chien : a-t-il été victime d’un traumatisme psychologique ou physique, et dans ce cas, utiliser des médications douces associées à une rééducation progressive pour surmonter cet épisode traumatique sera indiqué, avec l’aide d’un éducateur canin spécialisé et compétent, sans aucune méthode coercitive.
Mais parfois le problème est présent depuis le plus jeune âge du chien qui, comme les humains, peut présenter des troubles psychiatriques qui se révèlent avec le temps (ou qui deviennent intolérables avec le temps…) : hypersensibilité/hyperactivité, syndrome de privation…Certains peuvent amener à la disparition des séquences de prévention avant morsure. De ce fait, le vétérinaire donnera certes des conseils, entre autres de prise en charge par un éducateur, mais il pourra proposer surtout la prise en charge par un vétérinaire comportementaliste, spécialiste de cette matière, le seul habilité à prescrire certains traitements psychotropes qui, contrairement à ce que pensent beaucoup de personnes, ne sont pas là pour « abrutir » ou calmer le chien, mais qui aident son cerveau à fonctionner plus correctement, notamment en normalisant des niveaux de neurotransmetteurs jusque-là incorrects pour une réponse neuronale adaptée. Car, n’en déplaise à certains éducateurs canins, la psychiatrie canine existe bien, les maladies psychiques également, tout n’est pas qu’affaire d’éducation, même si cette dernière est importante. Enfin, il faut être conscient que tout traitement ou toute rééducation est un travail de longue haleine, et prévenir le propriétaire du chien qu’il peut y avoir des phénomènes ponctuels de régression.
Et dans le cas où le chien a mordu…
Le vétérinaire sera dans ce cas de nouveau dans le cadre d’une mission de santé publique : tout chien qui a mordu une personne, fût-elle son propriétaire, doit être présenté à trois visites sanitaires à une semaine d’intervalle, la dernière ayant lieu le 15ème jour après la morsure. Ce protocole a pour but de vérifier que le chien, au moment de la morsure, n’était pas porteur de la rage sans en présenter encore les symptômes, ceci afin de pouvoir soigner la personne mordue au mieux et éviter son décès.
La seconde obligation est de présenter le chien à une évaluation comportementale, afin de juger de sa dangerosité réelle, notée de 1 à 4. De nombreuses évaluations aboutissent à un classement « sans suite », car une explication « physique » peut être donnée ou parce que la morsure fait suite à une faute humaine. Sinon, l’évaluation permet de mettre le doigt sur un problème de comportement et/ou d’éducation, que le vétérinaire va conseiller de corriger en prenant contact avec un vétérinaire comportementaliste et/ou un éducateur canin.
Le problème réside dans l’évaluation de niveau 4 : à ce moment, le maire peut décider l’euthanasie du chien, face au danger qu’il peut représenter. Il est clair qu’un chien adorable qui « vrille » parfois sans signes préalables peut constituer un grave danger selon son environnement humain : imaginez face à un bébé qui commence à marcher…Et ce, même si ce trouble grave voit son origine dans des maltraitances antérieures commises par des humains. Le contexte de vie du chien est alors déterminant pour sa prise en charge. Il faut savoir également que le praticien n’est pas décisionnaire en la matière (d’ailleurs le vétérinaire qui pratique l’évaluation ne pratique pas l’euthanasie éventuelle), son évaluation est codifiée, et constitue une expertise dont il doit assurer le sérieux, tant pour l’animal que pour l’humain. A ce titre, le praticien choisit de réaliser cette expertise en s’inscrivant sur la liste des vétérinaires évaluateurs, et en se formant sur ce sujet. Attention, le vétérinaire évaluateur n’est pas forcément un vétérinaire comportementaliste ! Il est formé pour évaluer la dangerosité du chien, pas pour mettre une thérapie en place le cas échéant.
Un classement en niveau 4 n’implique pas une euthanasie systématique : il peut y avoir une demande de contre-expertise par un autre évaluateur, ou l’évaluation peut être renouvelée après quelques mois pour mesurer l’impact du suivi de comportement. Mais pendant ce laps de temps, il faut que le danger de morsure soit entièrement géré. Certaines structures proposent de prendre en charge le chien et sa rééducation lorsqu’elle s’avère possible, mais que le propriétaire ne peut ou ne veut pas l’assumer. La décision d’euthanasie est souvent liée à un faisceau de faits : volonté du propriétaire qui « n’y arrive plus », inaptitude à gérer le traitement ou la rééducation (dans ce cas, le maire peut prendre la décision au vu du danger possible), impossibilité de mettre hors de tout danger lié au chien les personnes vulnérables , échec des essais thérapeutiques, blessures importantes et/ou répétées sur les personnes ou les animaux…et, il faut l’admettre, l’appartenance aux chiens dits « de catégorie », car le délit de faciès existe bel et bien, malheureusement.
En conclusion, le devenir d’un chien « méchant » est loin d’être toujours l’euthanasie, fort heureusement. Mais dans certains cas, la question peut honnêtement se poser. Si le danger est réel et imprévisible, comment vivre avec ce chien ? Faut-il que sa vie se résume à rester seul dans une cage toute sa vie ? Sauver le chien et préserver l’humain ne sont pas toujours compatibles entre eux, mais aussi avec le bien-être du chien…

Brigitte Leblanc
Vétérinaire