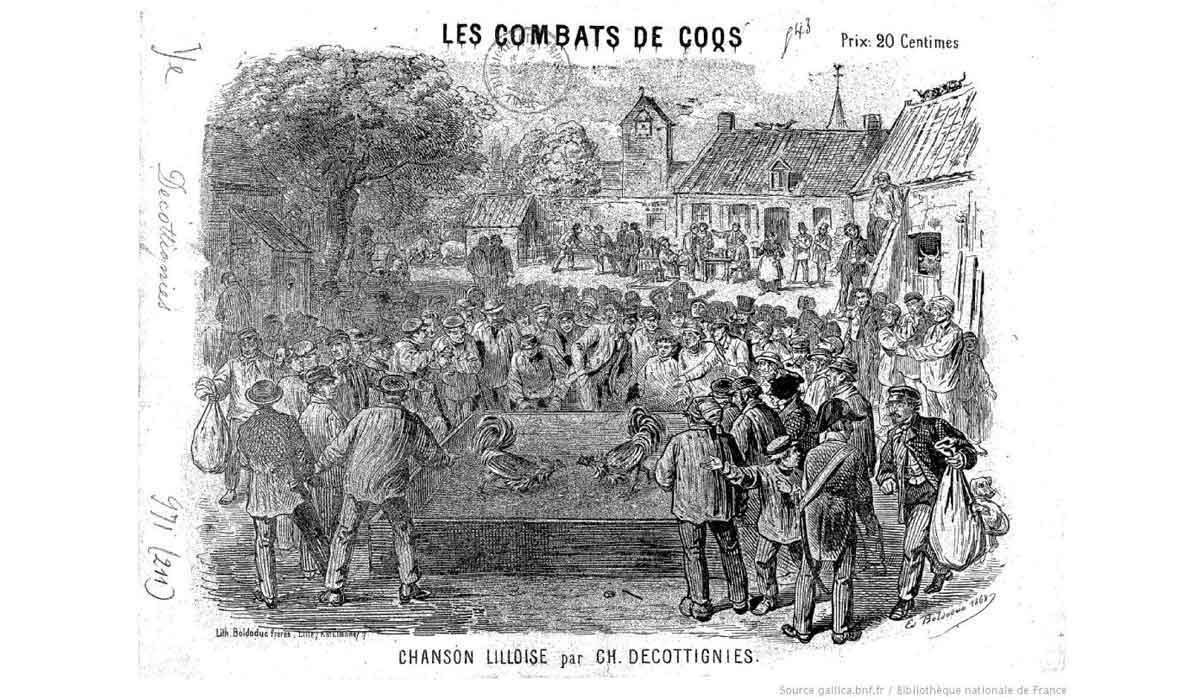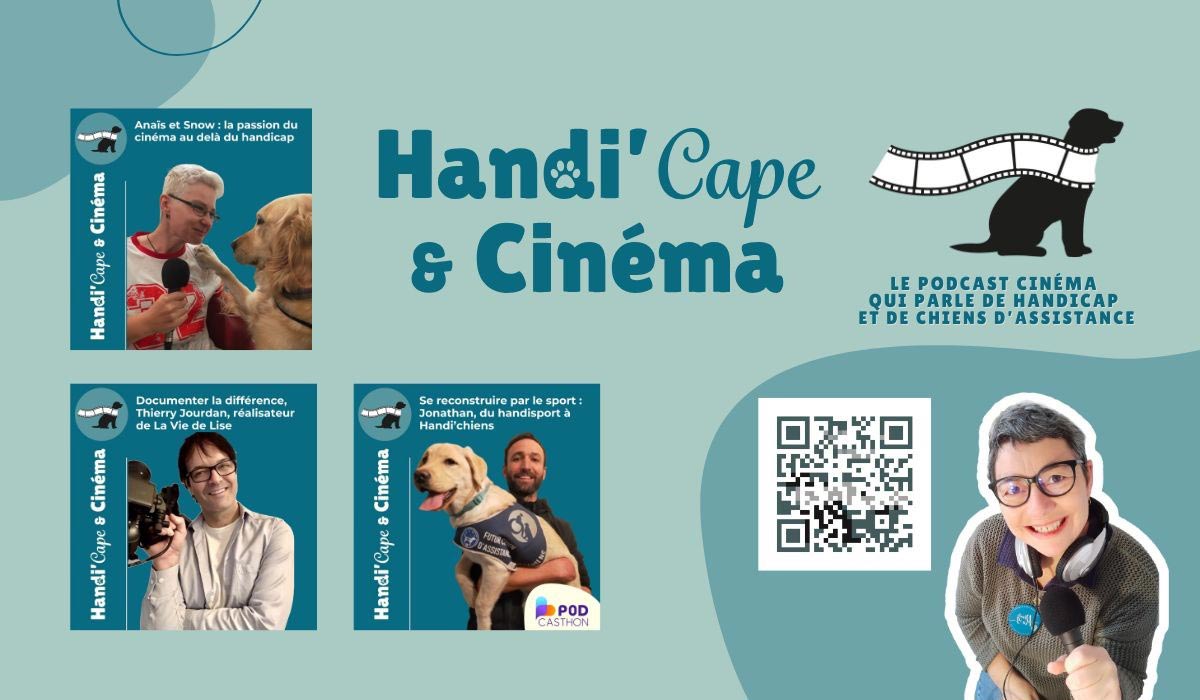Non, l’ostéologie n’est pas une discipline morbide. L’ostéologie est une discipline scientifique qui traite de la mort, certes, mais qui permet surtout l’étude des squelettes, qu’ils soient animal ou humain. Pour beaucoup, l’étude de la « mort » est incompatible avec l’étude de la « vie ». Pour certains, il est impossible d’aimer la vie sauvage, de vouloir la préserver, et parallèlement de s’occuper de squelettes et de les étudier.
C’est pourtant ce que je fais, et je vais vous montrer ici que l’étude de la « vie » et l’étude de la « mort » sont deux disciplines complémentaires pour comprendre le monde qui nous entoure. Je m’appelle Chloé, j’ai 24 ans. Depuis mes 10 ans, je reconstitue des squelettes d’animaux chez moi à des fins d’études anatomiques (l’anatomie comparée) mais également pour comprendre les comportements des animaux que je peux observer dans la nature, parce que oui, le pistage, la photographie animalière sauvage, et l’étude des mœurs animaliers font partie de mes passions. Ainsi, j’ai fait mes études à Sorbonne Sciences et au Muséum national d’Histoire naturelle de Paris en passant mon Master 2 « Biodiversité – Écologie – Évolution » parcours « Systématique – Évolution – Paléontologie » et ai créé ma micro-entreprise sur le Naturalisme, l’Ostéologie et la Paléontologie, Bi’Os’Diversité.
Des sangliers qui labourent la terre, des renards qui chassent, des chevreuils qui courent, des lapins qui sautent, des oiseaux qui volent. Nous avons tous vécu dans notre vie une de ces situations. Mais comment expliquer que chaque animal à un comportement qui lui est propre ? Pourquoi, par exemple, un chevreuil ne pourra pas chasser une souris comme peut le faire le renard ? Des réponses peuvent être apportées en étudiant le squelette de ces animaux.
Les dents sont un critère important pour comprendre l’attitude qu’adopte un animal dans la nature. Il en existe une grande variété, correspondant aux différents régimes alimentaires.
Chez les carnivores chasseurs, comme le renard, les dents sont pointues et tranchantes (dents brachyodontes-sécodontes), avec une grosse dent appelée carnassière qui aide pour la chasse. Chez les herbivores, tel que le chevreuil, les dents sont en forme de « croissants » (dents sélénodontes). On notera une absence d’incisives supérieures pour la rumination et des incisives inférieures en forme de « spatules » pour couper les végétaux. Cette morphologie explique les abroutissements que l’on peut retrouver dans la nature : la section des petits arbustes coupés n’est pas nette, témoignant de l’absence d’incisives supérieures. Chez les sangliers, on remarquera des dents plutôt arrondies (dents brachyodontes-bunodontes) typique d’un régime omnivore. Le sanglier peut en effet se nourrir de végétaux, champignons… mais également de viande, le sanglier étant aussi un charognard.
Les clavicules sont un autre critère important à prendre en compte pour comprendre le déplacement des animaux. Cet os joue un rôle crucial dans l’articulation de l’épaule (mobilité et stabilisation) et va permettre à plusieurs muscles du cou et de l’épaule de s’y attacher.
Lorsque l’on regarde un animal courir, particulièrement les animaux adaptés à la course rapide comme le cheval ou encore le guépard, on peut remarquer une grande amplitude au niveau de leurs membres antérieurs. Ce fonctionnement est notamment dû à une réduction voire à une absence des clavicules chez ces animaux, comme chez de nombreux placentaires (qui « accouchent de juvéniles »). Cette particularité permet à la scapula (omoplate) d’avoir davantage de liberté de mouvement. Cette réduction de la clavicule voire son absence va également être retrouvée chez les animaux qui utilisent des mouvements dits pendulaires – marche, course et nage -. À l’inverse, d’autres êtres vivants, les humains et autres primates notamment, ont ce besoin d’utiliser leurs bras pour faire des mouvements dits « complexes » comme l’apport de nourriture à la bouche. Ces animaux présentent des clavicules dites « fonctionnelles » permettant la stabilisation de la ceinture scapulaire : meilleures articulation et dissociation entre les mouvements bras-torse sont alors les conséquences de la présence de cet os.
D’autres mouvements « complexes » dépendent aussi de la présence d’une clavicule : le vol chez les oiseaux. Une question importante : comment font-ils pour supporter leur poids durant le vol ou au moment du décollage ? En regardant la structure interne de leur squelette, on se rend compte que leurs os présentent une structure interne lacunaire, ils sont « creux/vide », allégeant ainsi l’ensemble de leur corps. Comparativement, nos os ou ceux des autres mammifères (par exemple) présentent une substance spongieuse remplie de moelle, notamment au niveau des épiphyses des os longs.
D’autres critères sont également visibles selon les animaux. Chez les animaux coureurs, l’autopode est relevé, permettant une course plus rapide. Un allongement des membres permet aussi une augmentation de la longueur de leur foulée. Chez les animaux sauteurs, comme le lapin ou le lièvre, les trois segments à l’origine des mouvements de « flexion-extension » ont des longueurs quasi équivalentes, avec une patte postérieure en forme de « Z ».
Sur un squelette de ruminant, comme le chevreuil, la main est simplifiée, les os de l’avant-bras sont soudés, perdant ainsi leur mobilité. Cette anatomie du membre est strictement spécialisé dans la locomotion terrestre, la main se trouvant en position fixe de pronation. L’extrémité proximale de l’ulna du chevreuil est aussi très épaisse et proéminente, formant ainsi un bras de levier important : amplification de l’action des puissants muscles dits « extenseurs » de l’avant-bras peut avoir lieue.
Les sangliers sont connus pour labourer la terre en quête de nourriture grâce à leur groin. C’est en observant leur squelette que l’on se rend compte que ces animaux, comme les porcs, ont un os supplémentaire au niveau de ce groin, que l’on appelle l’os prénasal ou wormien maxillo-naso-incisif, élargissant et renforçant cette zone très importante pour ces animaux.
Crâne, membres, os isolés… nous avons vu que chaque partie du squelette peut nous aider à comprendre les comportements des animaux. Ostéologie et Nature sont donc pleinement complémentaires ! Convaincus ?

Chloé Aubry
Naturalisme, Ostéologie, Paléontologie
Bi’Os’Diversité - jeux de société, livres, posters pédagogiques et ostéologiques animaliers