Il est des regards qui transforment. Celui de Sebastião Salgado est de ceux-là. Longtemps photographe des drames humains, témoin infatigable de l’exode, de la guerre, de la misère, il s’est tourné à la fin de sa carrière vers les paysages, les animaux, les forêts. Non pas par fuite, mais par fidélité. Fidélité à la vie, dans toutes ses formes. Fidélité à la Terre, notre seule maison.
Du drame humain à la beauté du vivant
Économiste de formation, Salgado quitte le Brésil en 1969 pour fuir la dictature militaire. C’est à Paris qu’il découvre la photographie, qu’il adopte comme outil d’engagement. Ses séries Workers et Exodus l’imposent comme une figure majeure du photojournalisme humaniste. Mais ces années à arpenter les terrains de guerre, les camps de réfugiés, les mines d’or, l’épuisent profondément. Il tombe malade, à la fois physiquement et moralement.
Alors, au début des années 2000, il part chercher des lieux épargnés, des formes de vie encore indemnes de la destruction humaine. C’est le début de Genesis, un projet monumental qui l’emmènera durant huit ans sur tous les continents, à la rencontre des paysages primordiaux, des peuples racines, et des animaux sauvages.
Un chant d’amour à la planète
Dans Genesis, l’animal devient sujet. Il n’est plus un élément du décor ou une figure exotique. Il devient regard, mouvement, souffle. Salgado photographie les colonies de manchots empereurs en Antarctique, les éléphants du parc national de Kafue, les iguanes marins des Galápagos, les baleines, les lions de Namibie. Chaque image est un poème silencieux, un appel à la contemplation.
Le noir et blanc, marque de fabrique de Salgado, confère une dimension intemporelle à ces êtres vivants. Loin du spectaculaire ou du sensationnalisme, ses photographies nous disent : voici le monde tel qu’il fut, tel qu’il pourrait encore être si nous apprenons à voir autrement. L’animal devient alors un miroir. Il nous révèle notre propre sauvagerie, notre fragilité, notre place au sein d’un tissu commun du vivant.
Esthétique du respect
Ce qui frappe chez Salgado, c’est l’éthique du regard. Il ne vole pas l’image, il la reçoit. Qu’il s’agisse d’un enfant dans un camp de réfugiés ou d’un phoque éléphant sur une plage battue par les vents, la dignité est la même. L’image n’est jamais un spectacle, elle est une rencontre.
Chez lui, photographier un animal revient à le reconnaître comme sujet. Il ne s’agit pas d’humaniser l’animal, mais de se rappeler que l’humain lui-même est un animal. Qu’il est né de la Terre, qu’il en fait partie, qu’il ne peut s’en extraire sans se perdre.
Dans un monde où l’animal est souvent réduit à une ressource, un produit, un divertissement ou une nuisance, le regard de Salgado offre une autre voie : celle de la considération. De l’émerveillement. Du respect.
Instituto Terra : réparer la Terre
Cependant, l’œuvre de Salgado ne s’arrête pas à la photographie. Avec son épouse Lélia Wanick Salgado, il crée l’Instituto Terra, une organisation pionnière qui a replanté plus de 2,7 millions d’arbres dans la forêt atlantique brésilienne. Ce projet est une réponse concrète à la déforestation, à l’érosion, à la perte de biodiversité. Une manière pour l’artiste-entrepreneur de rendre à la Terre un peu de ce qu’on lui a pris. Voir ou revoir le documentaire Le Sel de la Terre (Wim Wenders, Juliano Ribeiro Salgado, 2014) permet de mieux comprendre cette transformation.
Le photographe témoigne. L’homme agit. La cohérence est totale.
Un héritage pour le vivant
Rendre hommage à Sebastião Salgado, c’est saluer une vision du monde. Une manière de faire de l’art un levier de conscience. Une manière de faire de la beauté un acte politique. Une manière, surtout, de faire de la photographie un cri silencieux pour le vivant.
À l’heure des bouleversements climatiques, des extinctions massives, de la maltraitance animale souvent invisible, son œuvre est plus nécessaire que jamais. Elle nous invite à ralentir, à regarder, à ressentir. Elle nous engage à refuser l’indifférence, à cultiver l’attention.
Salgado ne photographie pas seulement la nature. Il la raconte. Il la défend. Il l’aime.
Puissions-nous, à notre tour, apprendre à la regarder ainsi. Et surtout, puissions-nous, dans le sillage de ce regard, devenir à notre tour des sentinelles actives du vivant, des passeurs de beauté, des militants d’une cause animale qui ne sépare plus le soin de l’action.
Photo de KOBU Agency sur Unsplash

Christian Makaya
Enseignant-chercheur à Ascencia Business School
Chercheur associé à l’Université Paris-Nanterre
Responsable de la valorisation et du développement de la Revue Française de Gestion
Membre du board éditorial de l’International Journal of Techno-Entrepreneurship

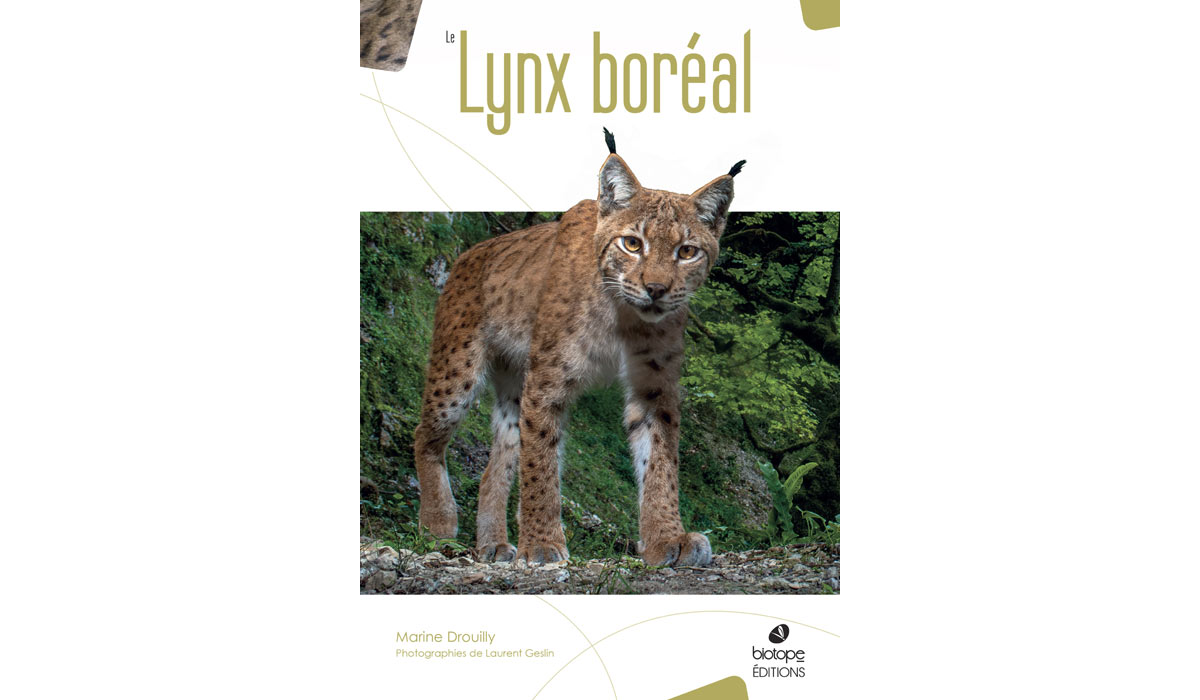

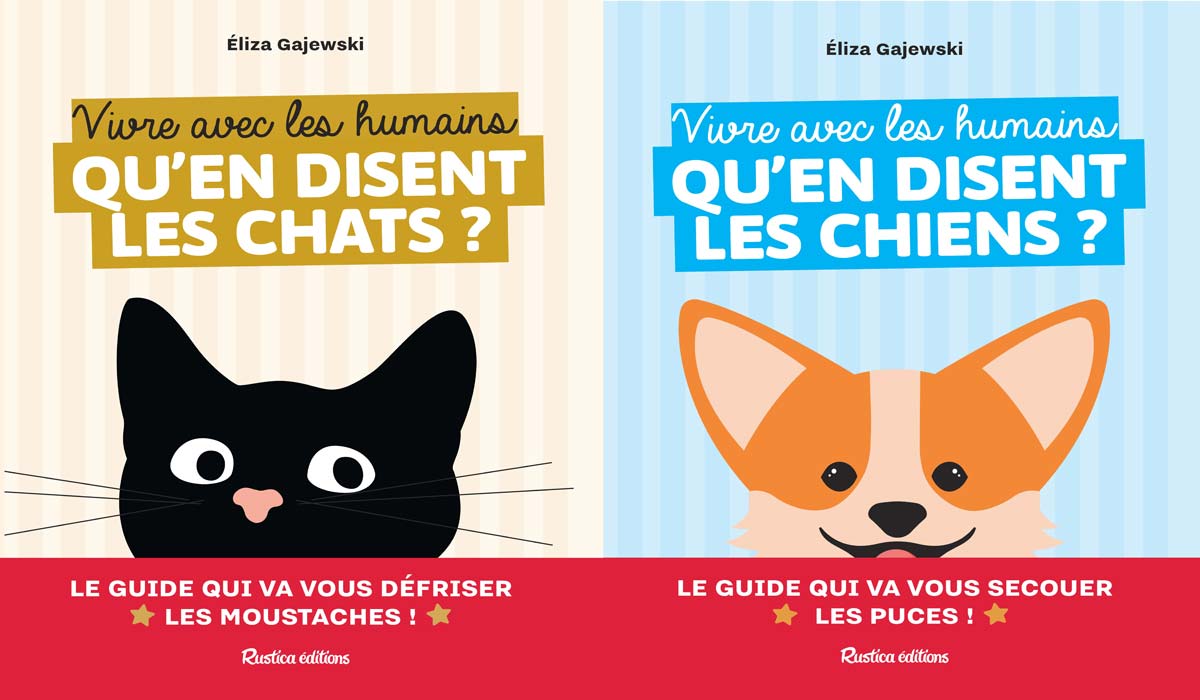
2 commentaires
Amelie HG
16 juillet 2025 à 10h27
merci pour cet hommage vibrant et ce bel article qui invite à découvrir l’oeuvre de ce photographe
Vanderplancke
15 juillet 2025 à 10h33
Très belle article et tellement utile dans cette époque d éveil !