Les chimpanzés et les gorilles montrent des comportements de combat et de poursuite qui, à un œil inexpérimenté, peuvent ressembler à de véritables affrontements physiques. Cependant, en analysant mieux le contexte, on peut voir qu’il s’agit en réalité d’un moment de jeu. La frontière entre jeu et combat agressif est très fine : les humains qui observent ces interactions peuvent facilement mal comprendre les deux comportements mais les animaux impliqués en reconnaissent parfaitement la nature et les interactions réciproques.
Mais qu’est-ce que le jeu chez les animaux exactement ? Selon la définition classique de Burghardt (2005), un comportement peut être défini comme “jeu” quand :
- Il n’a pas une fonction immédiate : il ne sert pas à se nourrir, à se reproduire ou à se défendre ;
- Il est spontané, volontaire, agréable et intentionnel ;
- Les modèles moteurs sont effectués de manière répétitive, mais non stéréotypée ;
- Il se déroule dans un contexte détendu, sans menace ni obligation ;
- Il est généralement effectué en l’absence de facteurs stressants, physiologiques, environnementaux et sociaux.
Le jeu a fait l’objet de nombreuses recherches, tant chez les jeunes animaux que chez les adolescents, mais la réalité est que les adultes jouent aussi. Il s’agit d’un comportement commun et ordinaire.

Mais à quoi cela sert-il de jouer ? Cela ne provoque-t-il pas une perte d’énergie inutile ? Dans de nombreuses espèces sociales – comme les primates – le jeu entre adultes a plusieurs fonctions qui vont au-delà du simple plaisir. Cela peut, par exemples :
- Renforcer les liens sociaux ;
- Réduire l’anxiété dans des contextes de forte tension sociale ;
- Exprimer et maintenir des relations coopératives;
- Tester les limites et les capacités physiques des individus.
Pour éviter que le jeu ne dégénère en un véritable combat agressif, les animaux mettent en œuvre des expressions faciales (play face, full play face), des vocalisations spécifiques et maintiennent une maîtrise motrice avec des pauses qui aident à réguler l’interaction. Un autre élément qui nous permet de distinguer les deux interactions est ce qu’on appelle le role – reversal (inversement des rôles) : l’individu dominant ou plus fort modère sa force et se met intentionnellement en désavantage pour permettre de prolonger la session de jeu. Cela permet de maintenir l’équilibre de l’interaction et sa réciprocité, signalant ainsi une activité ludique et non compétitive.
Il existe différents types de jeu : moteur, avec des objets et social. L’activité ludique peut être influencée par différents facteurs tels que la structure sociale, les relations de domination, l’âge, le sexe, la propension au jeu de l’individu, les conditions écologiques et l’espèce de référence.
Par exemple, il existe des différences entre le jeu social des chimpanzés et celui des gorilles adultes :
- Les chimpanzés montrent un jeu “chaotique”, c’est-à-dire des interactions plus intenses, variables et créatives. Ils jouent souvent face-à-face, font des pauses et changent de rôle.
- Les gorilles, en revanche, conservent un jeu “chorégraphié” : postures rigides, moins d’échanges de rôle et moins de signaux métacommunicatifs comme le play face et les pauses.
Grâce à ces différences, nous pouvons remarquer que la gestion de la communication et le contrôle moteur du jeu social varient également entre des espèces phylogénétiquement proches, c’est-à-dire des espèces qui sont proches du point de vue de l’évolution, comme les chimpanzés et les gorilles.

Il est crucial d’étudier la différence entre le jeu et la lutte agressive pour bien comprendre les dynamiques sociales des espèces animales. C’est un élément fondamental pour les chercheurs, les éthologues, les soigneurs, car il permet de distinguer correctement les deux interactions et d’évaluer l’état psychologique et relationnel des animaux afin de maintenir et protéger un niveau de bien-être élevé. Dans des environnements contrôlés, comme les zoos ou les centres de soins pour la faune sauvage, la qualité et la fréquence du jeu sont un indicateur indirect du bien-être animal : un individu qui joue est en effet capable d’exprimer son comportement naturel. Mais ce n’est pas tout : savoir comment les animaux distinguent le jeu de la lutte nous aide à mieux comprendre leur complexité émotionnelle et relationnelle. En conclusion, il nous rappelle combien le comportement animal est souvent plus riche, subtil et complexe qu’il n’y paraît à première vue.
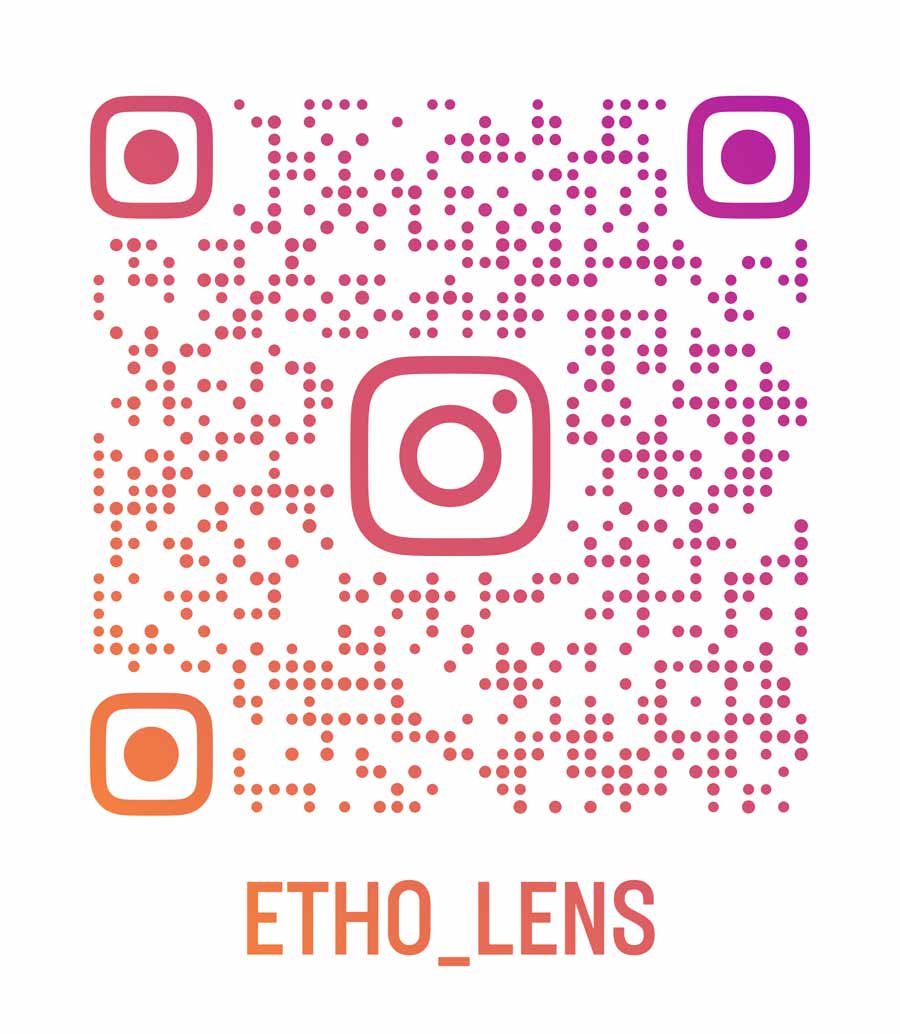

Etholens - Annarita
Éthologie Animale



